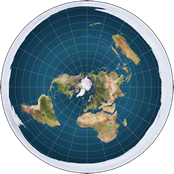Olivier Mathieu - Comment peut-on être provocateur ?
Autocritique et apologie
A Jose Luis Jerez Riesco
«Etre absolument personnel... dire les choses les plus abstraites de la façon la plus corporelle et la plus sanglante, l'histoire tout entière comme si elle était vécue et soufferte personnellement».
(Friedrich Nietzsche).
Derrière moi, j'ai entre autres cinq ans de journalisme, deux bouquins préfacés, une trentaine de conférences, une biographie d'Abel Bonnard aujourd'hui achevée après plusieurs années de travail; devant moi, cent projets, des livres en préparation. J'ai signé dans Rivarol, Ecrits de Paris, Marianne, Aspects de la France, la Nouvelle Revue de Paris, J'ai tout compris, Eléments, Panorama, Matulu, Spectacle du monde, Présent, National-Hebdo, Itinéraires, Minute, et à l'étranger, dans Elemente, Vouloir, Orientations. Aujourd'hui, je me retrouve à Europa-Kervreizh de Yann-Ber Tillenon, et je viens de publier mon premier article dans Diaspad. J'éprouve le besoin, ici, de dire pourquoi et comment. Non point par narcissisme, mais pour que ma propre histoire puisse servir, si peu que ce soit, aux membres actuels ou futurs du Mouvement européen. Je crois que j'ai le droit de parler.
Cinq ans de journalisme. J'ai été attaqué dans la presse belge (voir Le Soir de Bruxelles des 5-6 et 8 octobre 1985 ), dans la presse française (voir notamment L'Evénement du jeudi du 26 mars 1987). J'ai reçu des lettres de menaces de mort d'organisations juives comme de groupuscules d'extrême-droite. je crois, oui, être un homme libre. Et voici que le journal interne du G.R.E.C.E., Le Lien, vient de m'agresser à son tour en me traitant de «provocateur». Alors, je crois que j'ai le devoir de parler.
Libre, je le suis et veux l'être, mais la liberté individuelle et collective est toujours à conquérir, à travers une lutte qui n'aura de fin qu'à notre dernier jour. Je ne m'estimerai jamais assez libre. L'homme européen, le révolutionnaire véritable se construit peu à peu ; ses doutes, ses échecs, ses errances le mènent vers sa vérité, et vers la vérité. «Deviens qui tu es ! », nous exhortait le grand Friedrich Nietzsche. Et Pindare, le plus grand des poètes lyriques grecs (né en 518 avant l'ère chrétienne) avait écrit : «Sois tel que tu as appris à te connaître ! »
De mon enfance, très schématiquement, je conserve les images que voici : les premières années de ma vie, approximativement jusqu'à l'âge de six ans, je les ai passées dans des chambres d'hôtel, parce que ma mère était pauvre. Parfois, enfant clandestin, je changeais d'hôtel chaque jour. Ainsi je me revois, dans les rues, tenant la main de ma mère, pourchassé par les insultes des patrons furieux de n'avoir pas été payés. Je pourrais multiplier de tels exemples. Tels sont en effet mes souvenirs de l'âge où rien ne s'oublie, Ma mère n'a jamais touché d'allocations familiales. La seule fois où un huissier est venu la voir, ce fut pour lui demander d'en payer, des allocations ! Nourrisson, ma baignoire était une bassine de fer. Il pleuvait sur moi à travers le premier toit que j'eus. Je ne me complais absolument pas à évoquer cela - que j'ai vécu dans ma chair. Je dis simplement que les «Droits de l'Homme», c'est cela qu'ils ont fait pour moi. C'est-à-dire rien. Tout ce que la Démocratie m'a proposé, ce fut de me mettre à l'Assistance publique. J'y ai échappé d'un cheveu. Merci, Démocratie !
Dès lors, j'ai été un marginal, un exclu, un paria. Très tôt, par conséquent, j'ai senti L'ennemi. J'ai choisi, intuitivement, instinctivement, mon camp. La démocratie m'a inspiré la répulsion. Entre huit et douze ans, je jouais au ballon, quelquefois, avec des camarades. Mais, habile et adroit, je traversais sans difficulté le terrain jusqu'au but adverse sans que nul de mes adversaires ne parvienne à me faire perdre le contrôle de la balle, tandis que mes partenaires, de leur c ôté, m'adressaient de grands signes désespérés pour que je les fasse participer au jeu. En vain ! Et il se passait alors, invariablement ceci : les deux équipes se liguaient et se ruaient ensemble contre moi. C'est ainsi que je fus bien souvent roué de coups, et que les enfants de mon âge me jetèrent du sable dans les yeux. Ils avaient raison ! Raison de dire : «Le football est un sport collectif». Mais ils ajoutaient : «On est en démocratie». Et c'est cette petite phrase-là qui faisait mal, qui fait toujours mal. Je n'étais pas, moi, en démocratie. Tous avaient une télévision qui les attendait avec ses feuilletons américains à la maison ; tous allaient à l'école, où ils apprenaient l'américain, le franglais et les chambres à gaz. «On est en démocratie ! » Il ne s'agissait pas d'un ballon de foot. Il s'agissait que ma mère, eût-elle eu les moyens d'acheter une télévision, n'en voulait pas, ne voulait pas de la propagande euroccidentale. On ne m'a jamais gavé d'imposture. Il s'agissait que je n'allais pas à l'école - je ne suis jamais allé à l'école. Il s'agissait que j'étudiais le latin, le grec et l'allemand - des langues européenne - et que je lisais Drieu, Rebatet, Brasillach, Vallès, Sorel et Céline. Il s'agissait que, dès l'âge de quatre ans, j'avais dit ; «Je suis fasciste ». Les adultes souriaient ou s'offusquaient. Je laissais sourire et s'offusquer.
Et puis, j'ai été pendant des années, malade, alité, sans amis ; je suis resté seul, des jours entiers, dans l'appartement vide, pendant que ma mère allait travailler. Et je lisais - tel était mon seul plaisir d'enfant sans jouets - dans le journal, avant de les découper et de les coller dans un cahier, les articles qui concernaient la traque immonde dont était victime Klaus Barbie (pour ne parler que de lui) de la part des Wiesenthal et autres Klarsfeld, crapules et compagnie. Et des larmes coulaient sur mes joues. On pourchassait Barbie comme on m'avait jeté hors des chambres d'hôtel que ma mère ne pouvait payer, on pourchassait Barbie parce que le plus grand nombre, les imbéciles, les salauds, les vainqueurs étaient «en démocratie». Voilà ce que je voyais. Voilà ce que je vois. Vae victis.
Sautons quinze ou vingt ans : quinze ou vingt ans plus tard, devenu journaliste, je me suis aperçu que le journaliste, dans tout l'Euroccident, était le pire valet de ce système, qu'il le soutienne ou prétende le combattre. Le journaliste, à Paris, en France, aujourd'hui, n'est aucunement libre d'écrire ce qu'il veut. Il écrit ce que son rédacteur en chef veut qu'il écrive. Il écrit ce que le lecteur et le financier
du journal auquel il collabore veulent lire. Le journaliste, soi-disant d'opposition, est parfaitement toléré, il faut le savoir, par le système qu'il attaque et qui le nourrit. A condition de ne pas aller trop loin. Dès qu'un homme dépasse la limite de ce qui est permis, on le fait taire, en saisissant sa publication (les Annales révisionnistes), en l'accablant d'amendes (Faurisson), de peines de prison (Freda en Italie), en l'asphyxiant financièrement, en l'empêchant de travailler.
J'ai, pour ma part, traversé des années mauvaises. Des années de malaise. Obligé, pour des raisons financières, de collaborer à des journaux dont je ne partageais absolument pas l'idéologie, je craignais de m'y enliser, ce qui amenait heureusement des ruptures brutales (par exemple quand j'ai quitté le journal reagano-papiste Présent en déclenchant une polémique lors de la parution d'un article de moi dans le numéro 1 de J'ai tout compris), avec tel ou tel organe de presse du système occidental, mais pas avec ce système lui-même. J'avais, comme on dit, «le cul entre deux chaises». Ce qui expliquait que je m'enferrais inutilement dans des questions de personnes, et que des problèmes «sentimentalo-gélatineux», pour reprendre une expression, crue mais exacte, de Yann-Ber Tillenon, finissaient par me préoccuper davantage que ma réflexion sur l'avenir du Mouvement européen.
A partir du moment où il s'avérait que je ne pouvais m'exprimer véritablement, ni seulement traiter les sujets de mon choix nulle part, j'avais certes progressivement décidé d'abandonner le journalisme, mais sans parvenir à m' y résoudre totalement. C'est à ce moment que j'ai rencontré le G.R.E.C.E. et Alain de Benoist, en qui j'ai d'abord profondément et sincèrement cru. Païen, je l'avais toujours été. Mais une trop longue prostration dans les milieux réactionnaires commençait, je le confesse volontiers, à me rendre vulnérable aux séductions trompeuses du système euroccidental. Je dois au G.R.E.C.E., el plus particulièrement à Guillaume Faye d 'être resté fidèle à mes intuitions d'enfant, quant à l'opposition. la guerre, l'antinomie qui existe entre Europe et Occident.
Au début de 1986, j'ai donc préfacé Les Modérés d'Abel Bonnard aux Editions du Labyrinthe, ouvrage qui a été l'un des meilleurs suce ès de cette maison. A l'époque, Alain de Benoist et moi-même envisagions de travailler ensemble à une œuvre sur Georges Sorel, puis de publier, toujours au Labyrinthe, ma biographie d'Abel Bonnard. Comment en est-on arrivé, à peine deux ans plus tard, à ce que Le Lien conseille aux cercles grécistes de ne plus m'inviter à parler ? La réponse est complexe : plusieurs paramètres y interviennent, où il faudrait distinguer l'histoire propre du G.R.E.C.E. ; sa situation présente, avec le départ de l'un de ses plus brillants animateurs, Guillaume Faye ; ma propre histoire personnelle. J'ai cru, longtemps, que les dysfonctionnements du G.R.E.C.E. étaient dus à des causes conjoncturelles, au refus d'une certaine «vieille garde» de tout apport de sang neuf ; j'ai toujours été étonné, par exemple, par l'incapacité de nombreux intellectuels du GRECE à donner toute leur mesure aux talents des nouveaux venus ; on pourrait encore évoquer, au-delà de fautes de gestion et de procédés plus ou moins incorrects voire aberrants concernant la rétribution des divers employés, la confusion entre les responsables idéologiques et les responsables (?) financiers et d'énormes fautes humaines. Mais je crois que la leçon est claire, et qu'une phrase suffit : les dysfonctionnements du G.R.E.C.E. sont dus à des causes structurelles et Le G.R.E.C.E, tel qu'il est aujourd'hui, a failli à sa propre mission (après avoir accompli, il est vrai, un énorme travail). On ne peut qu'adhérer complètement aux analyses qu'a publiées Yann-Ber Tillenon (et auxquelles je renvoie) sur les rapports qu'entretiennent les paramouvements et le Mouvement européen ; sur les missions qui auraient pu, peuvent et doivent être les leurs désormais ; ou encore sur la différenciation public/privé dans l'attitude de certains, euroccidentaux pendant la semaine et nazillons boutonneux le week-end. Je m'explique.
En ce qui me concerne, le procès Barbie, exutoire de la haine collective des champions de l'intelligentsia judéo-parisienne et de la bonne conscience, des professionnels de l'indignation généreuse, des signeurs de pétitions qui ne prennent jamais que les armes des croisades sélectives, des roitelets de l'esprit qui, dès le kidnapping de Barbie en Bolivie, et même bien auparavant, avaient d'ores et déjà distribué les bons et les mauvais points, décidé du verdict et dicté les modes (Shoah), la parodie du procès Barbie, dis-je, m'a écœuré. Barbie est pour moi le symbole de l'innocent condamné par les impudiques. Innocent parce que, à supposer qu'ils ne soient pas simplement des fantasmes juifs, les faits reprochés à Barbie - au nom des lois écrites dont parlait Sophocle à travers Antigone - sont des faits de guerre. Et ce n'est pas à la paix de juger la guerre ! Innocent parce que la notion de crime contre l'humanité» est aberrante, surréaliste, ubuesque, kafkaïenne, dénuée de signification, sans portée juridique. Innocent parce que cet homme, menottes aux poings, était l'image même de l'humilité noble et farouche, de la résignation sereine. Les mains entravées de Klaua Barbie étaient belles : fait qui, dans un système vraiment juste, aurait dû suffire pour que l'acquittement soit prononcé. D'office.
Je dis, j'écris ceci pour une raison très simple. C'est que moi, je signe et publie ce que je pense. Tel quel, que cela plaise ou choque, je m'en moque. Mais je récuse tout nazebroquisme. Je ne suis pas d'extrême-droite : le national-socialisme appartient à notre capital historique. Je suis national-socialiste, non dans le passé, certes, mais dans l'avenir. Je ne prends pas Adolf Hitler pour le Diable. Par contre, ceux qui pensent comme moi, mais préfèrent leur feuille de paye, leur standing, l'entretien de leur petite amie ou le paiement de leur maison de campagne, destinée à leur ébats nostalgiques et à leurs solstices, aux idées qui sont censée nous être communes, ceux-là, je les appelle nazebroques. Je ne les nommerai pas. Tout le monde les connais, tout le monde les aura reconnus. Lâches, ou simplement idiots qui ne se rendent pas compte que, à quelque compromission "métapolitique" qu'ils s'abaissent, ils ne gagneront que le mépris de l'adversaire. On peut considérer mes écrits comme ceux d'un fou, comme penser que Yann-Ber Tillenon manie la langue-de-bois. Peu importe. Je m'assume. Libéralisme et socialisme, U.S.A. et U.R.S.S., paramouvements de type G.R.E.C.E. et système euroccidental, ce sont toujours les deux équipes de football liguées contre le Mouvement européen. Dans mon "enfance, je l'ai dit et le répète, j'ai été un révolté. A ce que les gens normés, conformistes, non libérés de la rationalité de l'adversaire, me disaient, je répondais : «je sais». Cela horripilait, cet enfant qui prétendait d'avance tout savoir. Mais aujourd'hui, je crois qu'en effet, je savais. Je sais que je savais. Dans Evola, dans Guenon, dans Abel Bonnard, dans Mussolini il est dit, sous des formes diverses, cette vérité incontournable : il y a ceux qui croient et ceux qui savent. Alors j'écris ceci, comme j'ai écrit ma biographie d'Abel Bonnard, pour ceux qui savent.
J'ai une constatation à faire. Au G.R.E.C.E., la plupart des gens, aussi loin que je m'en souvienne rétrospectivement, me paraissent avoir passé leur temps à me reprocher de ne pas porter de cravate... Cela est révélateur de la hauteur des réflexions et préoccupations de ce milieu. De Guillaume Faye, par contre, je garde une autre image. Je lui serait toujours redevable de m'avoir simplement répondu, un soir où je me posais des questions sur mon avenir immédiat, où je réfléchissais devant une alternative périlleuse, en me récitant «Le Loup et le Chien» de La Fontaine. Guillaume Faye venait de me prouver qu'il avait tout compris...
Exclu par les uns, trahi par les autres, tel est peut-être mon destin, J'en ai souffert longtemps, mais je n'en souffre plus. La démocratie est l'alliance des malhabiles, des idiots, des inférieurs, des incapables contre tout ce qui est grand, noble, pur. Les enfants qui, aujourd'hui me jetaient du sable dans les yeux sont ceux qui, aujourd'hui, avortons de la bourgeoisie euroccidentale, s'abrutissent devant Shoah. Ce sont eux, encore, petit bourgeois, fonctionnaires, rédacteurs stipendiés de la prétendue "grande presse" qui m'excluent de leurs sectes...
Un journaliste de gauche m'a traité, il y a peu, d' "historien amateur". En effet, il y a deux sortes d'historiens, les historiens officiels (Vidal-Naquet, B.H.L., Gallo, etc.) qui défendent le point de vue des vainqueurs de 1945, et les historiens amateurs qui plaident pour un traitement historique normal du national-socialisme et de toute l'histoire
européenne, Je revendique donc le titre d'historien "amateur" avec force et orgueil. Quant à ceux qui me traitent de "provocateur", je leur répondrai que je suis ravi de cette appellation, venant d'eux, qui assurément sont tout sauf des provocateurs : on relira par exemple l'article de Michel Marmin dans le Monde, après l'attentat de la rue Copernic, ou celui d'Alain de Benoist dans le Quotidien de Paris, pour se désolidariser de son ancien comptable Henri Roques. Je préfère "provoquer" que cirer les pompes. La vie est provocatrice !
Car si j'élève la voix, je poserai la question : de-quel droit me jugez-vous ? De quelle autorité vous érigez-vous en juges ? Vous qui n'avez rien réussi ! Vous qui n'avez rien tenté !
Aujourd'hui, les choses sont radicalisées, les coupures nettes. Il est logique que les matuvus et les matulus, les sous-hussards, les faux dandies, les poétereaux de Saint-Germain-des-Prés, les arrivistes, les philosophes ratés qui ne seront jamais que des compilateurs m'aient repoussé. Société et européenne embryonnaire et société euroccidentale sont en place. La guerre est déclarée. Sans sécurité sociale ni chômage, dos au mur et travaillant sans filet, comme Faye, je respire mieux depuis quelques mois et semaines ! Parce que, poussé dans mes contradictions par le système d'une part, par l'amitié dialectique de Yann-Ber Tillenon d'autre part, et enfin par moi-même, je suis désormais sur la voie de la cohérence politique et poétique avec moi-même.
Voici le moment venu d'achever cette autocritique quelque peu sommaire et succincte, qui n'engage que moi-même. Je voudrais la dédier, tout imparfaite qu'elle soit, à Guillaume Faye, qui m'a enseigné une vertu capitale : l'indifférence, et à Yann-Ber Tillenon, bourlingueur et - mieux que cela en ces temps submergée par le néo-primitivisme - barbare. Nous espérons l'avènement d'une société européenne, la notre, celle du Mouvement européen.
Olivier MATHIEU
23 juillet 1987
Révisionnisme - PDF E-book