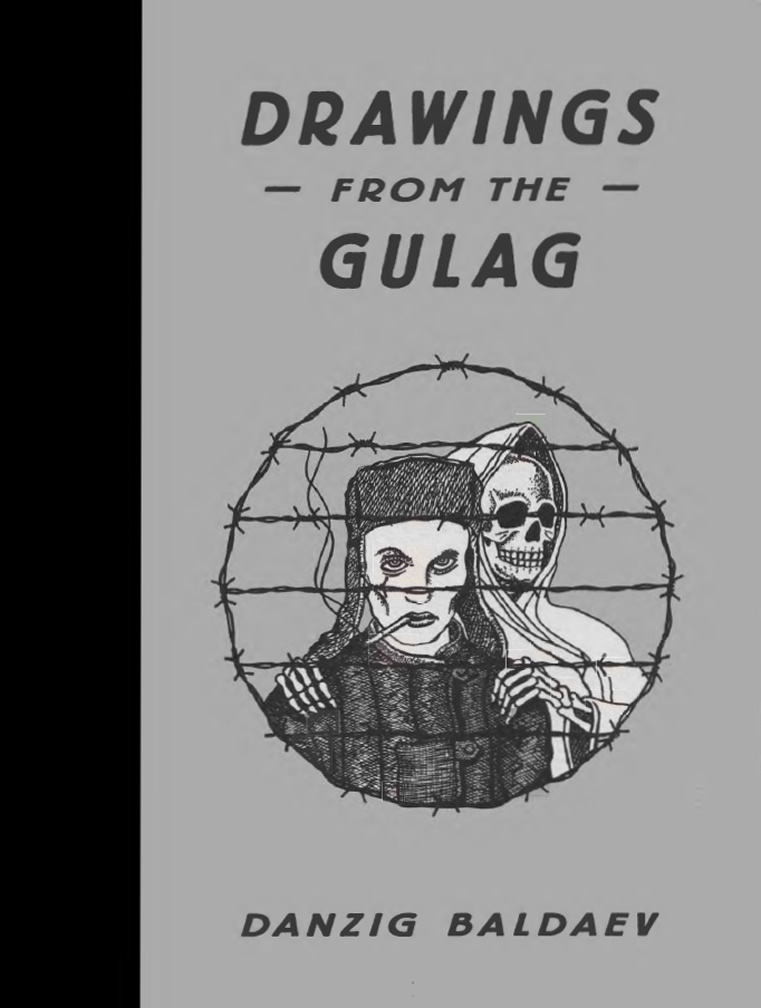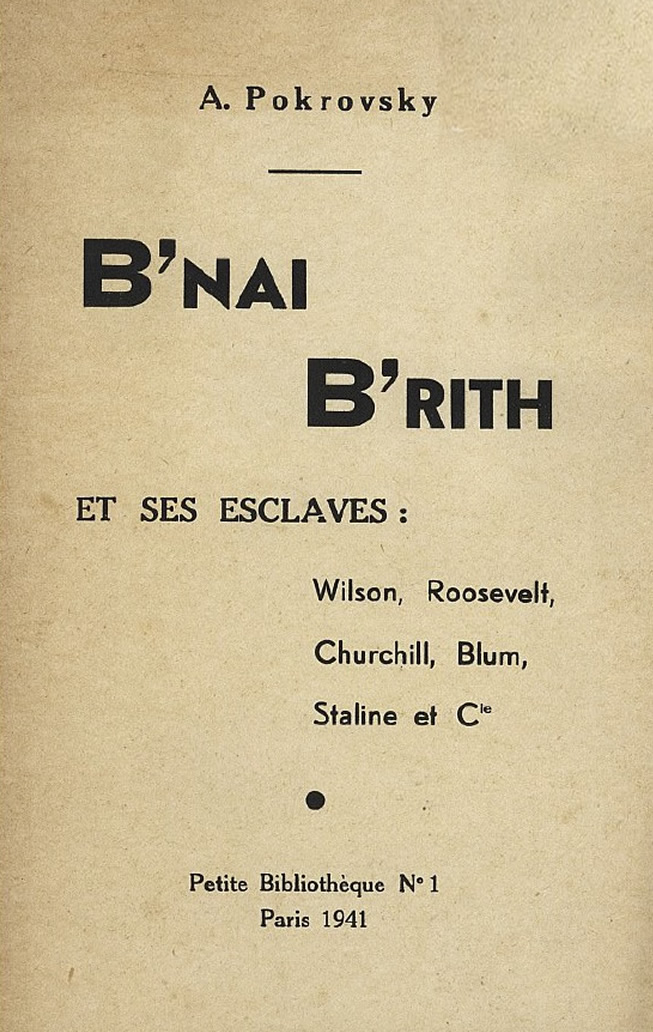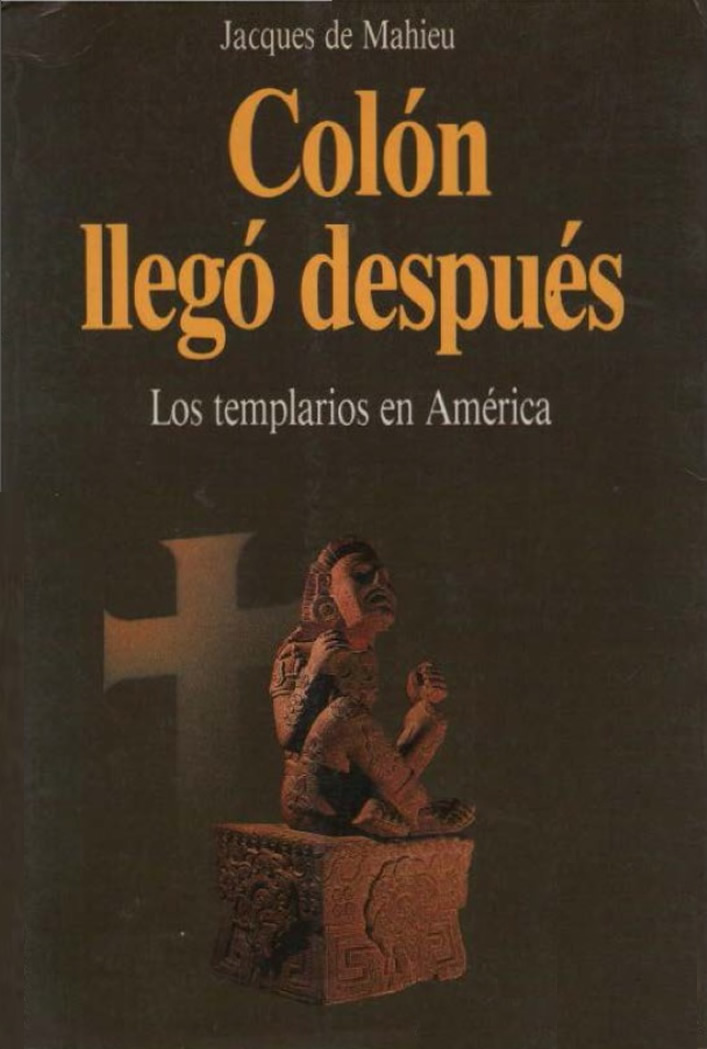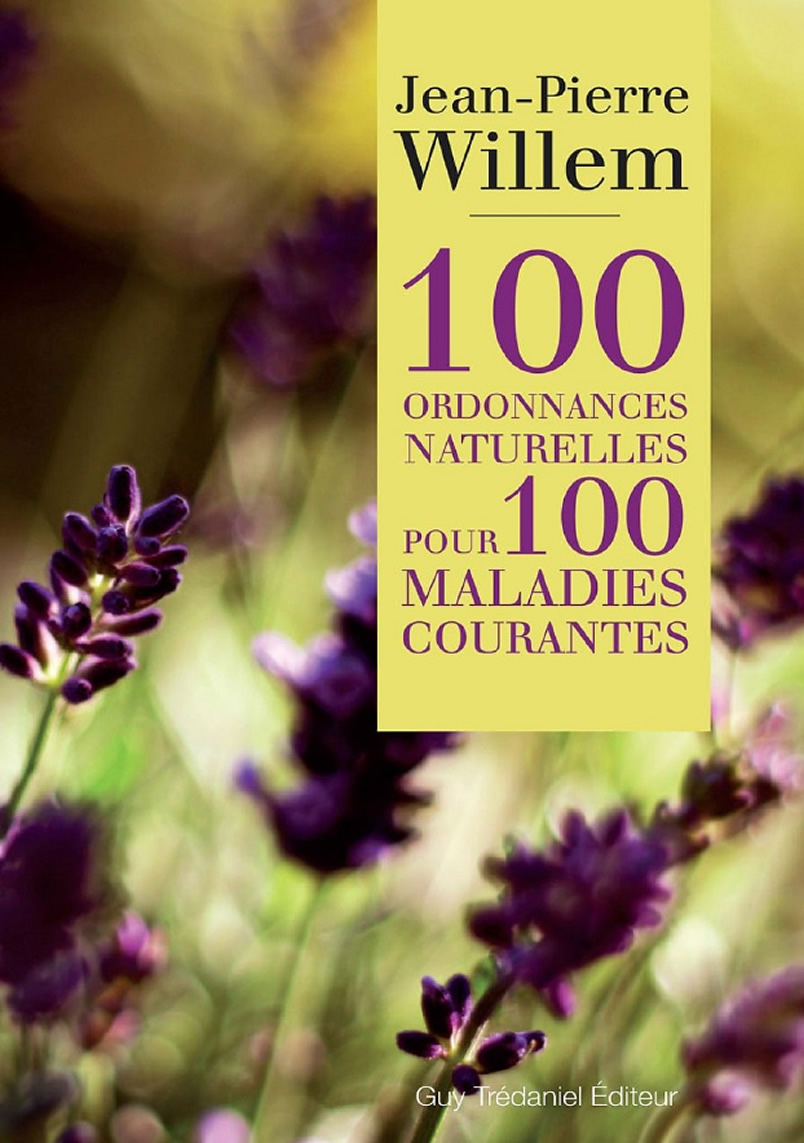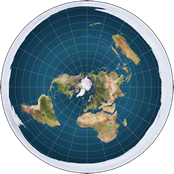Saint-Yves d'Alveydre - Mission des souverains
Par l'un d'eux
Acheter la version papier du livre
Une nouvelle version de l'histoire de l'Europe, déployée à partir de la lutte de pouvoir entre les papes et les souverains nationaux. Un ouvrage exigeant, dont le but n'est pas d'apporter de nouvelles connaissances, mais, en changeant la perspective, de réorganiser complètement les connaissances acquises. Cette relecture de l'histoire se termine par le projet d'une constitution européenne, supranationale, basée sur la Synarchie, le plan divin d'un État social terrestre.
Préface
J'expose avec confiance ces pages au plein jour de l'opinion publique.
Dictées par l'amour du bien, elles renferment ma pensée comme souverain chargé d'âmes et de destinées, et je crois cette pensée salutaire. Ma personne, pour le moment, n'importe pas, et ne sortira de l'anonyme que pour entrer en acte, s'il y a lieu d'agir dans le sens que j'indique.
Cette divulgation d'une nouvelle doctrine gouvernementale est déjà, par elle seule, un acte gros de faits à venir, si le besoin de vérité, de justice et de paix sociale qui me l'a dictée, est aussi général que je le pense, à tous les degrés de nos hiérarchies.
Depuis le livre du Prince, le machiavélisme le plus noir a souvent passé, à juste titre, pour être le conseiller secret des rois.
J'ai voulu en quelques pages mettre sous les yeux des peuples et de leurs chefs un nouveau livre d'État : celui du machiavélisme de la lumière. C'est pourquoi lisez, jugez, approuvez ou blâmez : j'écouterai approbations et blâmes, et si les premières dépassent en nombre les seconds, leur chiffre me dira que j'ai bien fait, et qu'il faut se mettre à l'action.
Une pareille action ne saurait avoir le caractère d'une réaction européenne, ni les mystères d'une sainte alliance.
Avant les cabinets, c'est l'opinion publique seule qu'il faut aborder premièrement.
C'est là qu'est la grande force, le seul levier capable de soulever l'Europe de l'ornière sanglante qui la conduit en Amérique.
Si la volonté générale de l'Europe se reconnaît dans cette oeuvre l'accomplissement en est facile.
Nous ne serons alors que les premiers agents d'une irrésistible puissance, sans laquelle notre pouvoir, plus ou moins habile à conserver ce qui est, demeure impuissant à créer ce qui pourrait être. C'est donc à l'opinion qu'il appartient de répondre, si mes voeux ont formulé les siens.
Elle a pour le faire des voies légales, pratiques et sûres : comités, adresses, délégations au chef de l'État, dans chaque État. Si cette pression morale sur les gouvernements acquiert une intensité suffisante, les pouvoirs publics européens devront, par nous, se concerter et agir souverainement pour une fin commune, autre que la conservation de nos droits menacés de diverses manières.
Puis, ce sera aux ministres et aux nations d'entrer en scène et de préparer le pacte fédéral et les institutions destinées à le garder. Aujourd'hui, plus nominaux que réels, les souverains ne sont que les gardiens d'une trêve armée qui ne leur permet pas les oeuvres de la paix. Conservation, destruction : tel est le dualisme qui limite brutalement la souveraineté, d'où toute réforme pourrait procéder.
C'est un cercle fatal qui nous étreint souverains et peuples, et que nous ne pouvons briser tous que par une sincère entente commune, préparée par un grand effort intellectuel et moral.
Depuis le traité de Westphalie ou plutôt depuis le Congrès d'Arras, le gouvernement général de l'Europe est un véritable état de siège, dont nous sentons vainement l'écrasante inanité.
Tant que ce système subsiste, aucune conception générale de gouvernement digue de nos temps n'est applicable, aucune action généreuse dans le sens des grands mobiles de la Société, des grands intérêts de la Civilisation, n'est pratique.
Sujets de la force, notre seule politique possible est de nous en saisir, sous peine d'en être saisis ; et notre seule activité pratique est une compétition diplomatico-militaire, inter-dynastique et internationale, dont le triomphe toujours éphémère coûte aussi cher, à tous les points de vue, que la défaite.
Valois, Wasa, Bourbon, Hapsbourg , Orange, Romanoff, Hohenzollern, Bonaparte, etc., nous tendons à rééditer périodiquement la même histoire, sans grand profit pour nous-mêmes, ni pour l'Europe ; nous tournons dans le même manège, dans le même champ clos féodal, qu'ensanglantent nos ambitions rivales, nos combats judiciaires, donnant aux peuples le spectacle d'une rixe de gladiateurs qui leur prouve par de perpétuels exemples que l'anarchie préside à nos rapports comme aux leurs. C'est la vie, diront les naturalistes, la vie avec ses luttes instinctives et ses compétitions passionnées.
Cependant l'état propre de l'homme n'est pas cet état de nature, mais l'État Social.
Dans chaque État, les passions et les instincts subissent le frein des lois civiles ; et les États d'une même famille sociale, ceux de la Chrétienté, ne sauraient sans danger demeurer longtemps encore moins contraints, dans leurs rapports mutuels, à la justice et à l'équité, que les individus. Chrétiens dans notre vie privée, civilisés dans nos habitudes domestiques, devrons-nous donc éternellement n'échanger entre nous, dans nos relations fonctionnelles, comme souverains, qu'une politique antichrétienne et barbare, instinctive et féroce, faite de ruse diplomatique, de violence militaire, et dont nos codes nationaux repoussent et poursuivent l'immoralité, quand nos sujets la pratiquent entre eux ?
Nulle intelligence, nulle conscience ne peut répondre affirmativement ; mais il est plus facile de réprouver le mal que d'en connaître exactement les profondeurs, les causes, et de pouvoir y remédier. La Maison européenne, la Chrétienté étant ainsi bâtie, nous sommes forcés d'en subir le statu quo, faute d'un meilleur plan et d'ouvriers pour la rebâtir.
Nous n'en sommes, malgré les apparences, que les premiers locataires, les plus exposés.
Pendant que la guerre permanente règne en haut, la révolution sape les fondations, et nous accule de plus en plus à la conservation matérielle de nos droits dynastiques et des droits de l’État à l'intérieur, de nos droits nationaux au dehors.
Pour le moment, en effet, et tant que la loi de nos rapports est ce qu'elle est, nous ne pouvons faire mieux qu'opposer une conservation matérielle au matérialisme de la destruction, aussi longtemps que les peuples ont assez de bon sens pour rester dans la logique de leur histoire et nous en confier l'application.
Mais nous ne devons pas nous dissimuler qu'ils peuvent cesser d'avoir ce bon sens, pour leur malheur sans doute, mais pour le nôtre aussi. Le matérialisme gouvernemental, et il remonte haut dans l'Histoire, tend partout, dans notre siècle positiviste, à réduire l'État à une sorte de machine anonyme, si bien montée par nous qu'elle semble pouvoir fonctionner d'elle-même, sans principe de vie politique.
Tel est, à proprement parler, le fond de la conception latine du gouvernement auquel les Occidentaux donnent le nom assez chimérique de république.
La France, sous ce rapport, ne varie pas, depuis Danton jusqu'à M. Gambetta.
Il est douteux que les peuples tirent jamais des républiques ainsi comprises, un autre avantage qu'une suppression apparente de la liste civile ; et il en résulte, pour eux, une série d'inconvénients politiques et sociaux, internes et externes, inutiles à relever ici.
Mais supposons un instant que les volontés nationales, plus ou moins surprises par la dogmolâtrie athéologique, par l'archaïsme universitaire, des soi-disant républicains, puissent supprimer partout la vie à la tête des États et réduire ceux-ci à leur simple automatisme administratif : l'Europe en sera-t-elle plus à l'abri de la guerre permanente qui est sa loi générale, les nations européennes échapperont-elles davantage à toutes les conséquences de l'état de siège européen ?
Toutes les déductions de l'Histoire prouvent le contraire.
Si la Révolution, considérant la destruction de ce qui est comme un moyen de faire place à ce qui doit être, avait en réserve un plan réalisable, répondant à la création d'un ordre de choses meilleur, la République, outillage monarchique sans monarque, pourrait prétendre à réaliser une certaine économie de transition.
Tel n'est pas le cas.
Bien plus civile que politique, oeuvre de demi-lettrés absolument dépourvus de toute science sociale, la Révolution n'a rien qui doive nous effrayer outre mesure ; et je crois, au contraire, ses exemples faits pour nous rassurer sur notre utilité pratique et nous démontrer que les vraies réformes ne peuvent venir que de nous.
Cette révolution n'est qu'une poussée bruyante d'une certaine partie, non satisfaite, des classes moyennes, sur des cadres créés par nous, et beaucoup trop satisfaisants pour qu'on les supprime.
À l’avant-garde des autres nations, la France est pour nous tous un théâtre d'observation dont les expériences portent leurs enseignements et leurs conclusions.
La Monarchie y est évincée, mais l'État y reste intact, tel que Louis XI l'a médité, tel que Richelieu l'a voulu, tel que Colbert l'a créé.
Nul ne songe à le détruire, chacun ambitionne de l'occuper.
La Révolution fait la poussée ; la République organise la substitution ; un fauteuil remplace le trône ; la couronne ne disparaît que pour faire place à un chapeau ; au sceptre succède une canne, en attendant un sabre, et tout est dit.
Pourtant, par moments, la Révolution semble se faire plus menaçante, et de civile qu'elle est, elle paraît, sous le nom de socialisme, vouloir revêtir un certain caractère antisocial.
Sentant vaguement le néant pratique de sa dogmolâtrie de son athéologisme universitaire, elle essaie d'y remédier en poussant ses archaïsmes jusqu'aux extrêmes ; mais, impuissante à rien créer, elle renouvelle de vieilles histoires, se divise contre elle-même, et oppose à l'État traditionnel, la Commune, tradition du moyen âge et des Étienne Marcel.
Que nous annonce cette réédition non corrigée ?
Le voici :
Une nouvelle poignée de demi-lettrés, trouvant que la politique est la carrière de ceux qui n'en ont pas, s'improvisent les interprètes des dernières classes pour les exploiter à leur profit.
L'Europe s'effraie, et elle a tort.
Laissons passer ces saturnales renouvelées des Romains, et concluons. Ce n'est encore qu'une nouvelle poussée tendant à une nouvelle substitution.
Tout ce monde peu nombreux, oisif, inexpérimenté, plus despotique que jamais nous ne le fûmes, ne veut gouverner ex abrupto que pour être quelque chose d'officiel : président, ministre, tribun, colonel de garde nationale, maire, commissaire de police, sergent de ville ou garde champêtre.
Chaque demi-bachelier paresseux se sent en poche une lettre de change sur les fonds publics.
La fonction visée, l'oripeau poursuivi, à grand renfort de phrases sonores, ne sont que le symbole de l'émargement au budget. Ce que je viens de dire aboutit à ce qui suit :
C'est qu'il en serait ainsi partout, en Allemagne comme en France, en Russie comme en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, partout en un mot.
Car toutes nos nations organisées sur le même plan, ayant érigé sur ce plan l'État, ne peuvent avoir que ce genre de république, sous peine de n'avoir pas de républicains.
En définitive, ce sera toujours l'état de siège national au dedans, mais plus grossier, plus gros de discordes civiles ; et ce sera plus que jamais l'état de siège européen planant sur toutes les nations du continent, mais plus lourdement et avec des résultats plus sanglants et plus onéreux. Car la politique sérieuse est une science faite de tact et d'expérience, une synthèse pratique de connaissances nombreuses, de traditions et de prudence, et tout cela ne s'improvise ni par des suffrages démagogiques, ni par des discours, ni par de soi-disant changements de gouvernement. Les États républicains d'Europe se heurteraient encore plus brutalement que sous nos vieux étendards, et enfantés par le vent populaire, ils engendreraient les plus désastreuses tempêtes. Nos liens de famille modèrent encore un peu la loi de ruse et de violence qui nous gouverne tous, le choc diplomatico-militaire de nos États armés les uns contre les autres.
Toutes les réformes réelles sont venues de nous, et je crois que nous seuls pouvons désarmer la guerre et organiser la paix publique, si nous savons, forts de la volonté de nos peuples, faire passer à l'État Social nos pouvoirs généraux européens, et fonder sur ses véritables bases l'Empire de la Civilisation.
Telle est notre vraie raison d'être, notre réserve supérieure d'utilité, la mission qui lie nos destinées à celles des nations et qui, seule, comme le prouvera ce livre, est la conclusion pratique des gestations sanglantes mais progressives de notre vieille Europe et de son histoire.
Saint-Yves d'Alveydre - La France vraie Tome 1
Saint-Yves d'Alveydre - La France vraie Tome 2
Saint-Yves d'Alveydre - Mission des juifs - Tome 1
Saint-Yves d'Alveydre - Mission des juifs - Tome 2
Marquis Saint-Yves d'Alveydre
Saint-Yves d'Alveydre - PDF